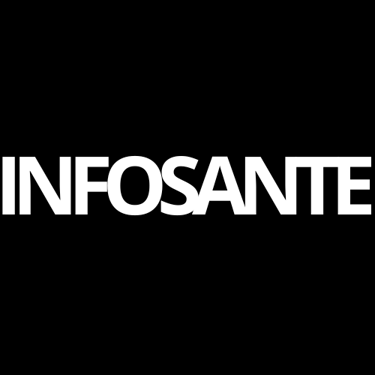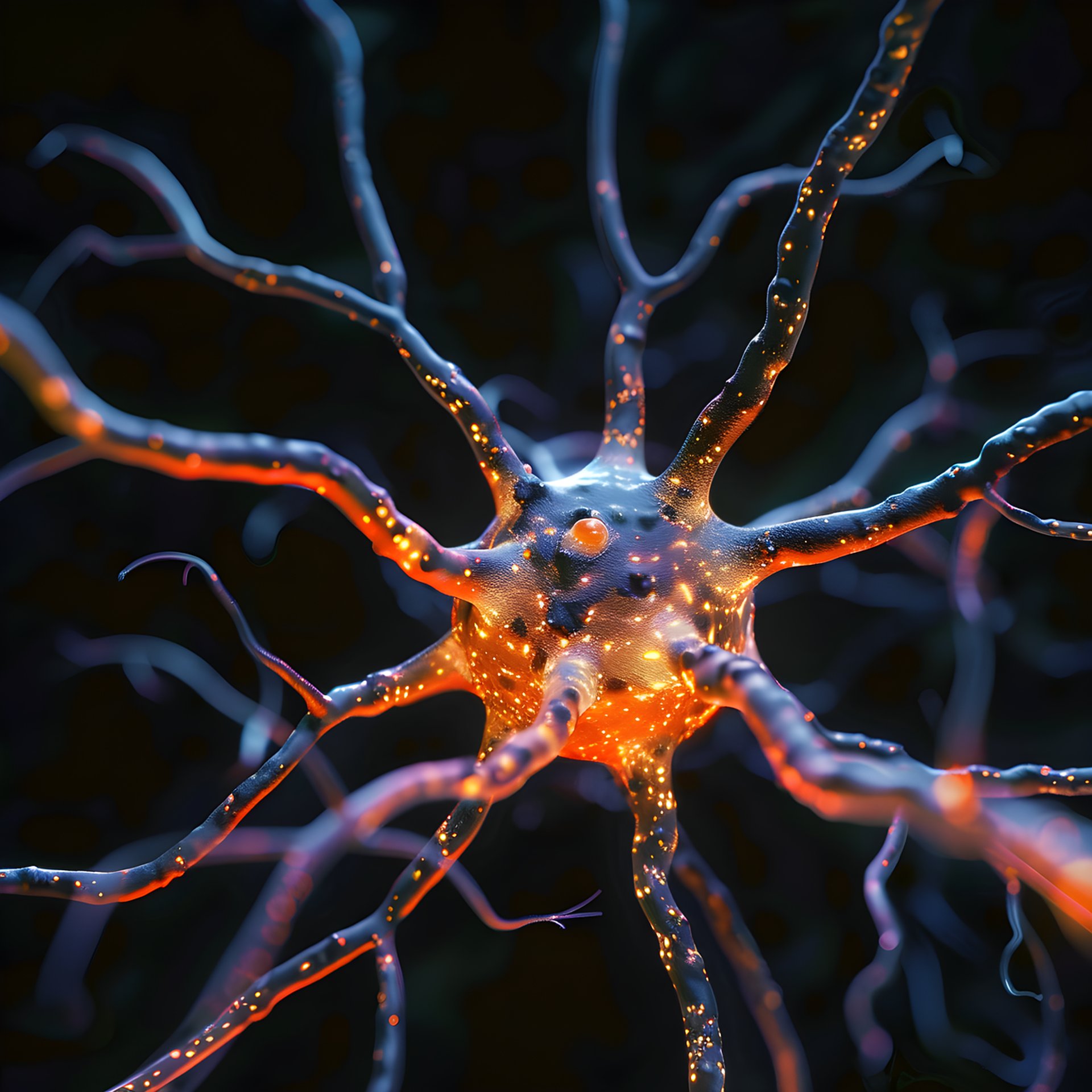
Sclérose latérale amyotrophique
La sclérose latérale amyotrophique est une maladie rare. On la connaît aussi sous le nom de maladie de Charcot. Elle atteint les neurones moteurs, les cellules qui commandent les muscles. Quand ces neurones meurent, les muscles se fatiguent, puis s’atrophient. Le corps se paralyse peu à peu. L’esprit, lui, reste généralement intact.
Les causes
Dans la plupart des cas, la cause reste inconnue. On parle de forme sporadique. Parfois, la maladie est familiale. Elle résulte alors de mutations génétiques (SOD1, C9orf72, FUS, TARDBP). Des pistes environnementales sont étudiées : métaux lourds, pesticides, traumatismes répétés. Rien n’est encore prouvé.
Les symptômes
Les premiers signes sont souvent discrets. Une main qui s’affaiblit, des crampes, des petits tremblements visibles sous la peau : ce sont les fasciculations.
Si l’atteinte est bulbaire, d’autres symptômes apparaissent : troubles de la parole, difficultés à avaler, voix qui s’éteint.
Avec le temps, la faiblesse gagne les bras, puis les jambes. Les muscles respiratoires eux-mêmes s’affaiblissent. Les réflexes deviennent exagérés, les mouvements raides. La sensibilité reste intacte, ce qui distingue la SLA d’autres maladies. L’intellect aussi, sauf rares cas où survient une démence fronto-temporale.
Le diagnostic
Pas de test unique. Le neurologue examine le patient, puis écarte d’autres causes.
L’électromyogramme (EMG) montre l’atteinte des motoneurones. L’IRM du cerveau et de la moelle permet de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une tumeur ou d’une compression. Dans certains cas, une analyse génétique complète l’examen. Le diagnostic reste délicat, souvent long.
L’évolution
La SLA progresse toujours. La vitesse varie, mais l’espérance de vie est en moyenne de trois à cinq ans après le diagnostic. Certains patients vivent plus longtemps. Stephen Hawking en est l’exemple le plus connu.
Les complications sont lourdes : perte de mobilité, perte de parole, difficultés à avaler, infections pulmonaires. L’insuffisance respiratoire est la complication la plus grave.
Le traitement
Il n’existe pas de guérison. Deux médicaments ralentissent légèrement la maladie : le riluzole et l’édaravone.
Le reste de la prise en charge est symptomatique : kinésithérapie, orthophonie, aides techniques, fauteuils motorisés. Des systèmes de communication assistée permettent de garder le lien.
Quand la respiration devient trop faible, une ventilation non invasive peut aider. Quand manger devient trop difficile, une sonde gastrique assure l’alimentation. Le soutien psychologique et familial est indispensable.
La recherche
De nombreux travaux sont en cours. Les chercheurs explorent les thérapies géniques, les cellules souches, de nouvelles molécules. L’objectif est clair : ralentir la dégénérescence des neurones, voire la stopper. Pour l’instant, aucun traitement curatif n’existe. Mais l’espoir reste présent.
En résumé :
La SLA détruit les neurones moteurs et entraîne une paralysie progressive. Elle n’altère pas la conscience. Même sans traitement curatif, une prise en charge complète permet de maintenir l’autonomie, la communication et la dignité.
InfoSanté
Des informations claires sur les maladies.
Prévention
Contacter nous sur infosantess@gmail.com
© 2025. All rights reserved.